




Le plan incliné





Copyright © Christian Delsanne pour CERB Club Des Éleveurs de Races Belges Ronquières Belgique
Le site du CERB a été créé en 1996.
Mises à jour en 2000, 2004, 2006, 2008 , 2010,2016 et 2021.




Club Des Éleveurs De Races Belges Ronquières
Informer | Inspirer

Club Des Éleveurs De Races Belges Ronquières
Informer | Inspirer
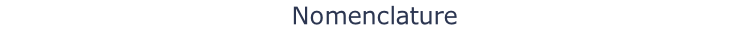
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour naviguer librement sur ce site. Votre identité ne nous intéresse pas. La navigation est totalement anonyme
Toutes les branches scientifiques possèdent une nomenclature qui leur est propre et la zoologie ne fait point exception à cette règle. La nécessité d'une terminologie spécialisée est pleinement justifiée et l'existence d'une telle terminologie est l'une des conditions du bon développement de tel ou tel domaine. La nomenclature scientifique permet au savant comme au profane quelle que soit sa nationalité de s'orienter facilement et précisément dans un domaine donné, car chaque entité systématique y est identifiée par un nom spécifique. Mais restons dans le domaine de la biologie. A l'origine, les animaux et les végétaux d'un certain endroit ont été désignés par des noms spontanés, locaux et donc variables, si bien que les savants avaient beaucoup de mal à se comprendre entre eux. Il était donc nécessaire de trouver une langue compréhensible à tous et de former des noms uniques, internationalement reconnus. Au Moyen Age, les personnes cultivées communiquaient à l'aide du latin et cette langue s'est conservée jusqu'à nos jours comme langage scientifique international.
Les premiers noms latins ont été formés un peu au hasard, comme jadis les noms propres de personnes, et ils étaient alors souvent longs et descriptifs. Le premier savant à avoir commencé à utiliser des noms scientifiques de manière systématique pour décrire les espèces animales ou végétales fut C. Linné, dans son traité «Systema naturae », plusieurs fois repris par Linné lui-même, après sa première édition de 1735. La dixième édition, parue en 1758, constitue le point de départ du développement de la systématique. Les savants décidèrent que seuls les noms mentionnés dans ce traité ont valeur scientifique, tous les noms antérieurs devenant par là même caducs. Jusqu'à la Révolution française, tous les scientifiques ont accepté sans difficulté la terminologie linnéenne et celle des autres grands savants du moment. Il n'y avait alors aucune règle de formation des noms nouveaux, seule comptait la loi de la priorité (le nom le plus ancien l'emportait sur le nouveau). Après la Révolution française, la communication entre les savants et les échanges d'informations furent pendant un temps interrompus, si bien que les espèces nouvelles furent décrites dans différents pays sans aucune coordination et il devenait très difficile de s'orienter dans la foison de noms nouveaux. La nécessité se fit donc jour de mettre sur pied des règles unitaires, impératives, pour codifier la création des noms nouveaux ainsi que des autres termes scientifiques. La première tentative de formuler de telles règles est contenue dans le codex anglais de Strickland, daté de 1842. D'autres suggestions suivirent, sans qu'aucune ne parvint à s'affirmer universellement. Il fallut attendre l'année 1901 et le congrès zoologique de Berlin pour voir reconnaître officiellement les règles admises par les savants. Ces règles furent complétées au cours des années. En 1958, le XV congrès zoologique international de Londres accepta un nouveau codex en français et en anglais (Code International de Nomenclature Zoologique - International Code of Zoological Nomenclature) qui est toujours en vigueur. Une commission Internationale de la Nomenclature Zoologique (I'ICZN) tranche d'autorité certaines questions difficiles ou controversées. La nomenclature linnéenne repose, comme la terminologie moderne, sur un système binominal (deux noms). Le premier nom s'écrit toujours avec une majuscule et indique le genre : Papilio, Felis, Anser, etc. Le deuxième nom s'écrit, lui, avec une minuscule et indique l'espèce . domesticus, silvestris, etc. Une nomenclature tri nominale, mentionnant la sous-espèce, représente un pas en avant dans la précision. Le nom de la sous-espèce commence bien évidemment par une minuscule. Il indique souvent l'origine géographique de la sous-espèce en question : Panthera tigris altaica, Rupicapra rupicapra tatrica, etc. La sous-espèce qui a servi de base à la description de l'espèce est le type et son troisième nom est identique au second : Parnassius apollo apollo.
Dans la littérature spécialisée, le nom de l'espèce ou de la sous-espèce est suivi de celui du savant qui a le premier décrit l'espèce ou la sous-espèce en question, et de la date de publication de la description, par exemple : Lacerta agilis Linnaeus 1758, Panthera pardus (Linnaeus, 1758). Lorsque le nom de l'auteur est entre parenthèses, cela signifie que l'espèce fut d'abord classée dans un autre groupe. Ainsi, Linné avait d'abord classé le léopard dans le genre Felis, sous le nom de Felis pardus Linnaeus, 1758. Par la suite, on s'aperçut que le léopard et d'autres grands félins présentaient un tel nombre de caractères particuliers qu'il valait mieux les ranger dans un genre autonome, Panthera. On écrit donc, Panthera pardus (Linnaeus, 1758).
Parfois, pour des raisons d'économie, les noms des auteurs les plus connus sont abrégés et la date est ommise (Lacerta agilis L.). Le respect strict des règles de nomenclature voudrait qu'on n'abrège ainsi que le nom Linné (L.) et Fabricius (Fabr.). Il n'est pas obligatoire de mentionner le nom de l'auteur et la date de la description, mais c'est important et nécessaire, car ces indications représentent souvent le seul guide dans la forêt des synonymes et des homonymes. Il arrive en effet que la même espèce soit décrite indépendamment par divers auteurs. La règle de la priorité veut que l'on conserve le nom le plus ancien, le premier publié. La date initiale est celle de la dixième publication du Systema naturae. Parfois, les deux descriptions sont séparées par plusieurs années et l'identification de la plus ancienne est facile, d'autres fois les descriptions portent le même millési me et il faut rechercher la date exacte de publication de la description. Les noms les plus récents deviennent des synonymes du nom ancien conservé. Mais il peut se produire que des noms soient invalidés pour d'autres raisons. En effet, la nomenclature suit une règle absolue qui est que le règne animal ne doit pas comporter plusieurs genres portant le même nom où, dans le même genre, plusieurs espèces de même nom spécifique. Ainsi, si l'on décrit un nouveau genre par exemple de coléoptères en lui donnant un nom qui existe déjà dans un autre groupe animal, ce nouveau nom est un homonyme inacceptable et doit être remplacé soit par le synonyme le plus proche dans le temps (lorsqu'il existe) soit par un nouveau nom.
De nombreuses règles s'appliquent pour ce qui est de la correction grammaticale des noms latins. Il suffit ici de dire que le nom générique a toujours valeur de substantif et que le nom spécifique est soit un substantif, soit un adjectif , soit simplement un groupe de lettres prononçables sans signification concrète. Lorsque le nom spécifique est un substantif, il doit être au nominatif ou au génitif, lorsque c'est un adjectif, il doit s'accorder en genre avec le nom générique. Pour éviter toute erreur, le zoologue est tenu de mentionner l'étymologie et le genre grammatical du nouveau nom de genre ou de sous-genre.
A côté de cette terminologie scientifique on trouve partout des noms communs populaires, moins précis, simples, reprenant les noms populaires traditionnels. Cette nomenclature est loin d'être exhaustive car elle ne porte que sur les espèces communes, présentant des caractères très particuliers, etc.
Les noms populaires présentent donc une valeur locale, mais lorsqu'on veut s'orienter précisément, on doit faire appel à la nomenclature scientifique.
| Nos expositions |
| Une exposition en bref |
| Marché paysan |
| Foire agricole de Soignies 2004 |
| Foire agricole de Soignies 2005 |
| Le souper annuel |
| Notre site |
| Présentation du club |
| Les canards |
| Les dindons |
| Les grandes volailles |
| Les volailles naines |
| Les lapins |
| Les pigeons |
| Les anatidés |
| Le canard domestique |
| Le canard sauvage "colvert" |
| Les canards de races belges |
| Liste |
| Histoire des dindons |
| Les dindons à Ronquières |
| Liste |
| Anatomie |
| Généralités |
| Liste des grandes volailles |
| L'aile |
| Bréchet |
| Pattes |
| Plumage |
| Queue |
| Squelette |
| Système circulatoire |
| Système digestif |
| Systeme musculaire |
| Système nerveux |
| Système respiratoire |
| Système uro génital |
| La tête |
| Origine |
| Définition |
| Domestication |
| Formation des races |
| Historique |
| Généralités |
| Liste des volailles naines |
| Photos de volailles naines |
| Barbus d'Anvers |
| Barbus d'Uccle |
| Brabançonne |
| Braekel |
| Fauve de hesbaye |
| Herve |
| Mehaigne |
| Tournaisis |
| Watermael |
| Généralités |
| Biologie du lapin |
| Liste des lapins |
| Photos de lapins |
| Argenté Belge |
| Beveren |
| Blanc de Termonde |
| Bleu de Ham |
| Gris perle de Hal |
| Steenkonijn |
| Generalites |
| Liste des pigeons |
| Photos de pigeons |
| Barbet Liegeois |
| Carneau |
| Cravaté gantois |
| Cravaté Liégeois |
| Culbutant belge |
| Haut volant belge |
| Ringslager belge |
| Smerle des flandres |
| Smijter |
| Speelderke |
| Voyageur belge |
| Voyageur Liégeois |
| L'agriculture |
| La fécondation |
| L'origine des oiseaux |
| En péril |
| La domestication |
| Le règne animal |
| Les fermes |
| Evolution |
| Système zoologique |
| Nomenclature |
| Distribution |
| L'adaptation |
| Communication |
| L'habitat |
| La vie sociale |
| Les expressions |
| Un jour un dicton |
| Contes et légendes |
| Fables de La Fontaine |
| A poil ! |
| Un canard boiteux |
| Du coq à l'âne |
| Poser un lapin |
| Fier comme un pou |
| Entre chien et loup |
| Sa langue au chat |
| Connu comme le loup blanc |
| C'est chouette ! |
| Janvier |
| Février |
| Mars |
| Avril |
| Mai |
| Juin |
| Juillet |
| Aout |
| Septembre |
| Octobre |
| Novembre |
| Décembre |


