




Le plan incliné





Copyright © Christian Delsanne pour CERB Club Des Éleveurs de Races Belges Ronquières Belgique
Le site du CERB a été créé en 1996.
Mises à jour en 2000, 2004, 2006, 2008 , 2010,2016 et 2021.




Club Des Éleveurs De Races Belges Ronquières
Informer | Inspirer

Club Des Éleveurs De Races Belges Ronquières
Informer | Inspirer
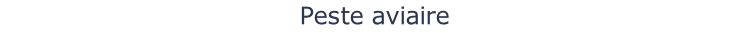
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour naviguer librement sur ce site. Votre identité ne nous intéresse pas. La navigation est totalement anonyme
PESTE AVIAIRE (INFLUENZA AVIAIRE)
Etiologie
Cette infection est provoquée par un virus influenza de type A (Orthomyxoviridae). Un grand nombre de souches différentes d'influenza A ont été isolées d'oiseaux : elles couvrent tous les 15 sous-types connus d'hémagglutinine (HA, H) et tous les 9 sous-types connus de neuraminidase (NA, N), dans toutes les combinaisons possibles.
Chez les oiseaux, les souches sont classées en 2 pathotypes :
1. les souches très virulentes (peste aviaire, highly pathogenic avian influenza, HPAI) de sous-type H5 et H7 ;
2. les souches peu pathogènes sauf lorsqu'il y a coinfection avec d'autres agents infectieux.
Le virus semble posséder une bonne résistance dans le milieu extérieur surtout en présence de matière organique et à basse température: 30 à 35 jours dans des matières fécales à 4°C et jusqu'à 105 jours dans du lisier. Le virus est facilement inactivé par la chaleur survie de 7 jours à 20°C. Le virus est inactivé par la plupart des désinfectants usuels. Dans les élevages atteints, une première mesure consiste à chauffer les bâtiments à haute température pendant quelques jours puis à les désinfecter à l'aide de d'hypochlorite de soude ou de formol. Le contrôle des litières contaminées est l'un des facteurs cruciaux dans le contrôle des infections à Influenza.
Transmission
La contamination peut se faire par contacts directs et indirects avec le virus qui est excrété en grande quantité dans les sécrétions et les matières fécales des oiseaux infectés. Il n'y a pas de transmission verticale de la maladie.
Transmission à l’homme
La transmission directe de virus influenza A aviaire à l’homme est rare, mais a été démontrée lors du récent épisode improprement dénommé " grippe du poulet " qui sévit à Hong Kong en 1997 : une souche de type H5N1 est passée directement du poulet à l’homme en provoquant au total 18 cas humains parmi lesquels six cas de mortalité. La transmission à l’homme se fait par aérosol au contact de volailles infectées. La consommation de produits de volaille est donc sans danger
Dans l’épidémie actuelle, il n’y a pas de danger pour la population qui n’est pas directement exposée. En effet, aux Pays-Bas et en Belgique, il s’agit d’une souche de type H7N7, or les souches aviaires qui se transmettent le plus fréquemment à l’homme, quoique exceptionnellement, sont de type H5 ou H9. Cependant, le contact prolongé avec des matières infectées permet la transmission du virus H7N7 des oiseaux à l’homme. On a décrit un cas de conjonctivite bénigne chez une patiente en 1996, associée à une infection par une souche H7N7. Dans l’épisode actuel de peste aviaire, plusieurs dizaines de personnes ont présenté une conjonctivite liée à l’infection par le virus H7N7. Un médecin vétérinaire hollandais est décédé d’une maladie respiratoire et le virus H7N7 a été isolé des poumons. L’infection humaine reste cependant un événement rare. Il ne peut se produire que si la personne est soumise à de fortes doses de virus et de manière répétée. Cela concerne donc les personnes exposées aux volailles ou au virus pour des raisons professionnelles.
La vaccination contre la grippe est obligatoire pour les personnes professionnellement exposées en élevage avicole ou dans le cadre de la lutte contre la peste aviaire aux Pays-Bas et en Belgique. En effet, le risque d’émergence d’un virus influenza pathogène pour l’homme est beaucoup plus élevé si une personne est infectée simultanément par une souche aviaire et une souche humaine. Dans ce cas, le réassortiment entre les génomes des deux virus aviaire et humain (cas particulier de recombinaison génétique) peut mener à la création d’un virus hautement pathogène pour l’homme. La vaccination permet de réduire le risque d’infection de l’homme par le virus humain et donc le risque de création d’un nouvelle souche virale. De plus, le personnel reçoit également des vêtements de protection et un traitement à base de médicament anti-viral pour lutter contre l’infection virale.
Dans la situation actuelle, il n’y a pas de risque pour la santé de la population. Les produits à base de viande de volaille et les œufs ne présentent aucun danger pour le consommateur.
Epidémiologie
Les oiseaux marins et migrateurs sont les deux réservoirs sauvages essentiels. Dix-sept épidémies de peste aviaire avaient été observées depuis 1959. Les plus récentes avaient touché l'Australie, le Mexique et le Pakistan en 1994; Hong Kong et l'Italie en 1997. Il semble malheureusement qu'il faille ajouter les Pays-Bas depuis 2003.
En ce qui concerne les autres pathotypes, des souches de virus influenza de type A sont présentes dans le monde entier. Depuis 1997, des formes graves d'influenza ont été observées avec le sous-type H9N2 en Iran, Arabie Saoudite, Pakistan, Chine et dans les pays asiatiques.
Pathogénie
La virulence d'un virus influenza est dépendante du clivage de l'hémagglutinine en deux protéines par un clivage protéolytique. Si le virus infecte une cellule qui possède un tel système de clivage, il peut alors se disséminer et infecter d'autres cellules. En l'absence du clivage, seul du virus non infectieux est produit. L'hémagglutinine de tous les virus influenza aviaires est clivée par les cellules épithéliales respiratoires et intestinales. Les souches hypovirulentes restent au site local d'infection. Les souches hypervirulentes sont sensibles à des protéases qui se rencontrent dans de nombreux tissus : elles peuvent atteindre les organes profonds et s'y multiplier, produisant des nécroses, une maladie grave et la mort de l'oiseau.
Signes cliniques
La période d'incubation est de 3 à 14 jours au sein d'un troupeau. Les signes cliniques dépendent du pouvoir pathogène des souches.
Avec les souches hypervirulentes, les premiers signes cliniques observés sont de l'abattement, une chute de la consommation alimentaire et une diminution des productions (chute de ponte). Ensuite, des signes cliniques respiratoires (toux, larmoiement, jetage, cyanose, dyspnée) et digestifs (diarrhée) apparaissent. Des conjonctivites aiguës parfois hémorragiques, de la congestion et de l'œdème de la crête et des barbillons, des congestions voire des hémorragies cutanées et de la cloacite hémorragique sont également observées. Avec certaines souches très virulentes, on peut n'observer que des morts subites sans signes cliniques préalables. Les taux de morbidité et de mortalité sont très variables et dépendent des souches. En cas de peste aviaire, les taux de mortalité usuels sont de 50 à 89 % mais peuvent atteindre les 100 %.
Les signes cliniques sont aggravés par des infections secondaires, par exemple par le virus de la pseudo-peste aviaire (maladie de Newcastle).
Les infections par les souches virales moyennement virulentes sont responsables de pertes économiques importantes, non par le taux de mortalité, mais par la chute de production des oeufs, l'atteinte respiratoire, la diarrhée et l'anorexie. Elles sont surtout rencontrées chez le dindon.
Lésions macroscopiques
A l'autopsie les lésions macroscopiques dépendent de la virulence des souches mais ne sont généralement pas pathognomoniques. Dans les formes suraiguës on n'observe habituellement aucune lésion significative. Dans les formes aiguës on peut observer des signes de déshydratation, de l'aérosacculite et de la péricardite exsudative, des conjonctivites, de la trachéite, des ovarites hémorragiques, des pétéchies et des ecchymoses dans la graisse abdominale, sur les séreuses et en surface du proventricule.
Lors d'infection par des souches hypovirulentes, les lésions sont principalement respiratoires (trachéite, aérosacculite).
Diagnostic
Seul un diagnostic de suspicion peut être posé sur base des signes cliniques et des lésions à l'autopsie. Lors d'épizootie, la peste aviaire doit être suspectée lors de toutes mortalités suspectes ainsi que lors de pathologies respiratoires ou digestives. Le diagnostic différentiel des formes graves comprend le choléra aviaire (infection à Pasteurella multocida) et la forme vélogène viscérotrope de la maladie de Newcastle. Dans les formes atténuées, il comprend toutes les causes de pathologies respiratoires (laryngo-trachéite infectieuse aviaire, bronchite infectieuse, formes mésogène et lentogène de maladie de Newcastle, mycoplasmose).
Seul le diagnostic de laboratoire est concluant. Le virus est isolé à partir d'écouvillons du cloaque et de trachée, mais aussi d'organes profonds (coeur, intestin, rate), et est inoculé à des oeufs embryonnés de poulet. Le virus est également détecté par diagnostic moléculaire (PCR). L'examen sérologique doit déterminer à quel sous-type appartient le virus influenza isolé (inhibition de l'hémagglutination).
Contrôle de l'infection
Il n'existe aucune vaccin commercialement disponible. Tout traitement des animaux atteints est interdit d'autant que la peste aviaire est une maladie contagieuse au regard de la loi, fait partie des maladies de la liste A de l'Office International des Epizooties (OIE) et de plus fait l'objet d'un contrôle sévère par l’Union Européenne. Dans ce cadre, l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) a déjà pris des mesures et un arrêté ministériel datant 27 février 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire a été publié dans le moniteur belge le 6 mars 2003.
| Nos expositions |
| Une exposition en bref |
| Marché paysan |
| Foire agricole de Soignies 2004 |
| Foire agricole de Soignies 2005 |
| Le souper annuel |
| Notre site |
| Présentation du club |
| Les canards |
| Les dindons |
| Les grandes volailles |
| Les volailles naines |
| Les lapins |
| Les pigeons |
| Les anatidés |
| Le canard domestique |
| Le canard sauvage "colvert" |
| Les canards de races belges |
| Liste |
| Histoire des dindons |
| Les dindons à Ronquières |
| Liste |
| Anatomie |
| Généralités |
| Liste des grandes volailles |
| L'aile |
| Bréchet |
| Pattes |
| Plumage |
| Queue |
| Squelette |
| Système circulatoire |
| Système digestif |
| Systeme musculaire |
| Système nerveux |
| Système respiratoire |
| Système uro génital |
| La tête |
| Origine |
| Définition |
| Domestication |
| Formation des races |
| Historique |
| Généralités |
| Liste des volailles naines |
| Photos de volailles naines |
| Barbus d'Anvers |
| Barbus d'Uccle |
| Brabançonne |
| Braekel |
| Fauve de hesbaye |
| Herve |
| Mehaigne |
| Tournaisis |
| Watermael |
| Généralités |
| Biologie du lapin |
| Liste des lapins |
| Photos de lapins |
| Argenté Belge |
| Beveren |
| Blanc de Termonde |
| Bleu de Ham |
| Gris perle de Hal |
| Steenkonijn |
| Generalites |
| Liste des pigeons |
| Photos de pigeons |
| Barbet Liegeois |
| Carneau |
| Cravaté gantois |
| Cravaté Liégeois |
| Culbutant belge |
| Haut volant belge |
| Ringslager belge |
| Smerle des flandres |
| Smijter |
| Speelderke |
| Voyageur belge |
| Voyageur Liégeois |
| L'agriculture |
| La fécondation |
| L'origine des oiseaux |
| En péril |
| La domestication |
| Le règne animal |
| Les fermes |
| Evolution |
| Système zoologique |
| Nomenclature |
| Distribution |
| L'adaptation |
| Communication |
| L'habitat |
| La vie sociale |
| Les expressions |
| Un jour un dicton |
| Contes et légendes |
| Fables de La Fontaine |
| A poil ! |
| Un canard boiteux |
| Du coq à l'âne |
| Poser un lapin |
| Fier comme un pou |
| Entre chien et loup |
| Sa langue au chat |
| Connu comme le loup blanc |
| C'est chouette ! |
| Janvier |
| Février |
| Mars |
| Avril |
| Mai |
| Juin |
| Juillet |
| Aout |
| Septembre |
| Octobre |
| Novembre |
| Décembre |


